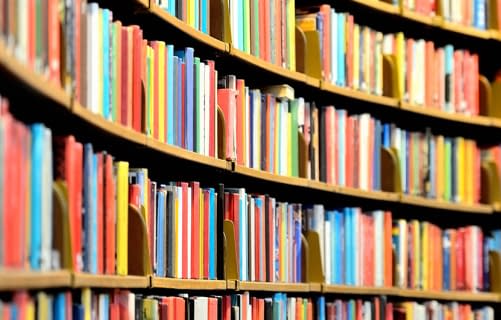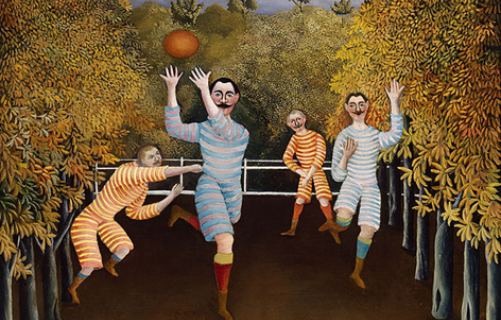Bref résumé
Il est architecte de formation, a travaillé pendant des décennies comme scénographe dans l’industrie du cinéma, et a toujours été un artiste visuel. Dans cet entretien avec art24, German Pizzinini parle de l’interaction entre ses parcours professionnels et sa peinture, de la thématique centrale de ses œuvres, et de l’influence des évolutions sociales sur ses concepts artistiques.
Vous avez déjà assumé de nombreux rôles différents dans votre vie. Votre travail de scénographe dans le cinéma, avant de vous consacrer entièrement aux arts plastiques, est particulièrement remarquable. En quoi vos expériences dans le monde du cinéma et les impressions visuelles du décor influencent-elles encore votre peinture ?
Je voudrais d’abord clarifier une chose : je ne construisais pas les décors – je les concevais, je les planifiais et j’en dirigeais la réalisation. Je n’étais pas constructeur de décors, mais scénographe (dans les pays anglophones, on parle de Production Designer). La scénographie fait partie des arts plastiques. Pour chaque production, je m’installais un atelier personnel, où je continuais à peindre en parallèle. L’idée ou la métaphore d’une scène dont je devais créer l’environnement visuel représentait toujours pour moi un défi que je voulais relever de manière artistique.

Vous avez aussi travaillé comme architecte. Les éléments graphiques de l’architecture ont-ils laissé des traces dans votre peinture ?
L’architecture implique une confrontation réelle avec l’espace, la tridimensionnalité – en particulier la perspective. Cette expérience m’a été extrêmement utile pour la transposition spatiale et chromatique dans mes œuvres.
Pourquoi avez-vous finalement opté pour une carrière dans les arts plastiques ? Qu’est-ce qui vous a davantage attiré que les plateaux de cinéma ou l’architecture ?
Comme je l’ai déjà mentionné : j’ai toujours été un artiste plasticien – seuls les points focaux ont changé avec le temps. Durant ma période en architecture, je me suis surtout consacré aux formes d’expression graphique. Avec mon entrée dans le monde du décor pour les productions cinématographiques, il y a 45 ans, la couleur est devenue un élément central – et j’en suis venu naturellement à me tourner davantage vers la peinture.
Vous dites vouloir raconter des histoires à travers l’art. Pourquoi ce besoin de narration est-il si important pour vous ? Et pourquoi la peinture est-elle pour vous le bon médium ?
La peinture non-informelle me sert plutôt d’étude, pour explorer les compositions colorées, l’effet spatial et la profondeur émotionnelle. En tant qu’œuvre d’art autonome – ce que je respecte tout à fait – je la trouve souvent simplement décorative. En revanche, je souhaite transmettre quelque chose au spectateur : une impulsion à réfléchir, qu’il s’agisse de quelque chose de personnel, d’actualité ou simplement d’une sensation – mise en œuvre avec des éléments réalistes, comme métaphore ou de manière symbolique. La peinture est pour moi le meilleur moyen d’expression.
Votre biographie indique qu’en 1976 vous avez cofondé un groupe d’artistes appelé « les Naturalistes critiques ». Le mouvement voulait aller à l’encontre de la tendance de l’art abstrait. L’abstraction était-elle à l’époque un sujet qui suscitait de la peur ? Qu’est-ce que vous considérez comme la force particulière de l’art figuratif ?
Dans les années 1970, les arts plastiques, surtout à Vienne, étaient fortement marqués par la politique. Le réalisme – quelle qu’en soit la forme – était considéré comme de gauche, parfois même qualifié de communiste. Les artistes avaient le plus souvent une sensibilité sociale, mais se distançaient des organisations politiques – sauf quelques exceptions. L’art abstrait, en revanche, était perçu comme conservateur, voire de droite. Ce n’est pas un hasard si son représentant le plus en vue était un monseigneur.
L’art abstrait – surtout l’informel – ne représente pas un défi direct sur le plan du contenu. Il ne peut donc pas susciter de peur, tout au plus de l’incompréhension, de l’indifférence ou du rejet. Il faut s’y confronter intensément pour y accéder. La peinture figurative, même lorsqu’elle est altérée ou stylisée, offre bien plus de possibilités pour provoquer une réaction de fond chez le spectateur.

Quelle est aujourd’hui votre position vis-à-vis de l’art abstrait ?
L’art abstrait sérieux peut tout à fait me représenter un défi, et je le respecte. Il existe cependant aussi un art spéculatif, qui ne signifie absolument rien pour moi.
Avec le recul, rejoindriez-vous à nouveau un tel mouvement ? En quoi cette phase a-t-elle façonné votre compréhension artistique ?
Indépendamment du fait qu’aujourd’hui je n’ai plus aucune ambition d’appartenir à un groupe, je ne le referais probablement pas. L’enthousiasme initial et la dynamique d’un groupe s’estompent vite – ce qu’il en reste, c’est une convivialité sociale. Et cela ne me suffisait pas.
Après la dissolution du groupe en 1983, vous avez poursuivi l’évolution de votre style en solitaire. Quels changements peut-on observer dans votre art depuis ? Qu’est-ce qui a changé dans votre façon de travailler et de vous exprimer ?
J’ai quitté le groupe dès 1979. Par la suite, mon environnement professionnel a eu une influence plus forte sur moi, de même que la possibilité de visiter des musées dans toute l’Europe. Cela m’a ouvert un accès plus profond à la symbolique, à la métaphore et aussi à l’abstraction.
Vous décrivez aujourd’hui votre style comme un « expressionnisme baroque ». Que signifie exactement ce terme pour vous ? Et voyez-vous un lien entre les époques baroque et expressionniste ?
Le terme « expressionnisme baroque » a été forgé par ma femme. Il décrit la richesse du baroque combinée à la palette chromatique des expressionnistes – des couleurs claires, éclatantes, travaillées de manière dynamique et rapide.
Le cycle « Temps de la peur » est une œuvre centrale, née dans le contexte de la crise des réfugiés de 2015/2016. À cette époque, environ deux millions de personnes fuyaient vers l’Union européenne. Quelles histoires et émotions abordez-vous dans cette série ? En quoi est-elle encore d’actualité aujourd’hui ?
Le problème reste d’actualité en Europe. Rien qu’en Autriche, il y a environ 26 000 demandes d’asile par an – sans compter les quelque 90 000 citoyens ukrainiens. Le point de départ de ce cycle a été un reportage sur la situation des réfugiés dans des camps internationaux ainsi que dans le plus grand centre d’accueil autrichien, à Traiskirchen.
Le cycle se compose de six tableaux, regroupés thématiquement : les auteurs de la peur, les personnes effrayées, et les gardiens de la peur. Le racisme et la xénophobie sont bien plus répandus en Autriche que ce que la version officielle laisse entendre. Par cette exposition, je voulais rendre ce problème visible. « Migration et fuite accompagnent l’histoire de l’humanité depuis toujours – provoquées par les changements climatiques, les conflits armés ou les catastrophes naturelles. Ce qui serait nouveau, c’est un concept d’intégration mutuelle. »


Dans votre œuvre « Café », vous abordez les mutations sociales causées par les nouvelles technologies et les médias. Considérez-vous la peinture comme une forme de contre-mouvement dans ce contexte ? Si oui, pourquoi ?
Non – je ne considère pas la peinture comme un contre-mouvement. Elle se situe aujourd’hui dans un champ de tension entre art traditionnel et nouvelles technologies. Contrairement au flux éphémère d’images sur les réseaux sociaux, la peinture offre un espace de réflexion, de concentration et de profondeur artisanale. Elle ne vise pas l’efficacité, mais l’engagement. En ce sens, la peinture n’est pas dépassée aujourd’hui – elle est plus pertinente que jamais.

Dans de nombreuses œuvres, vous soulevez des questions morales et éthiques et réfléchissez à la vie en société. Utilisez-vous l’art comme un outil pour attirer l’attention sur des injustices sociales ou des problèmes mondiaux ? Votre art est-il toujours ancré dans un contexte global ?
Oui, absolument. La peinture est pour moi le moyen d’expression que je maîtrise le mieux pour transmettre au public des thématiques socialement importantes.
L’art a le pouvoir de faire réfléchir. Pensez-vous que l’art a une responsabilité d’aborder les questions de société, ou peut-il aussi être simplement un plaisir esthétique ?
Quelle que soit la façon dont on utilise l’art – il a toujours un effet social. Cela implique aussi une responsabilité.
Y a-t-il d’autres thèmes ou motifs qui « dorment » encore en vous et que vous souhaitez absolument réaliser à l’avenir ? Pourriez-vous nous en dévoiler certains ?
Il y a encore beaucoup de thèmes et de motifs, mais je ne planifie pas à l’avance. Mes sujets naissent généralement de manière spontanée – à partir d’expériences, de situations fortuites ou d’événements sociétaux.

Pourriez-vous imaginer expérimenter d’autres techniques que la peinture ? Si oui, lesquelles vous attirent ?
Si un sujet l’exige, je peux envisager n’importe quel matériau. En 1986, j’ai réalisé avec VALIE EXPORT une installation pour l’exposition « En hommage à Beuys » au Lenbachhaus à Munich, à base de cuivre, feutre, plastique et huile. À la même époque, j’ai également créé quelques sculptures en pierre et métal.
Quand la toile devient voix

L’œuvre de German Pizzinini témoigne d’un parcours artistique cohérent – animé par le désir de montrer plus que de belles images : il veut raconter, questionner, secouer. Sa représentation réaliste, enrichie de symboles et de métaphores, est un moyen pour réfléchir aux évolutions sociales, aux impressions personnelles et aux expériences collectives. Ainsi, sa peinture est profondément ancrée dans le présent. Et c’est là que réside la pertinence de German Pizzinini. Il montre que l’art peut toucher, déranger, interpeller – surtout à une époque où tant de choses restent en surface.
Découvrez d’autres œuvres de German Pizzinini sur son profil art24 – et laissez-vous inspirer par des tableaux qui racontent des histoires.
L'interview a été réalisée par : Yvonne Roos
Auteur: German Pizzinini